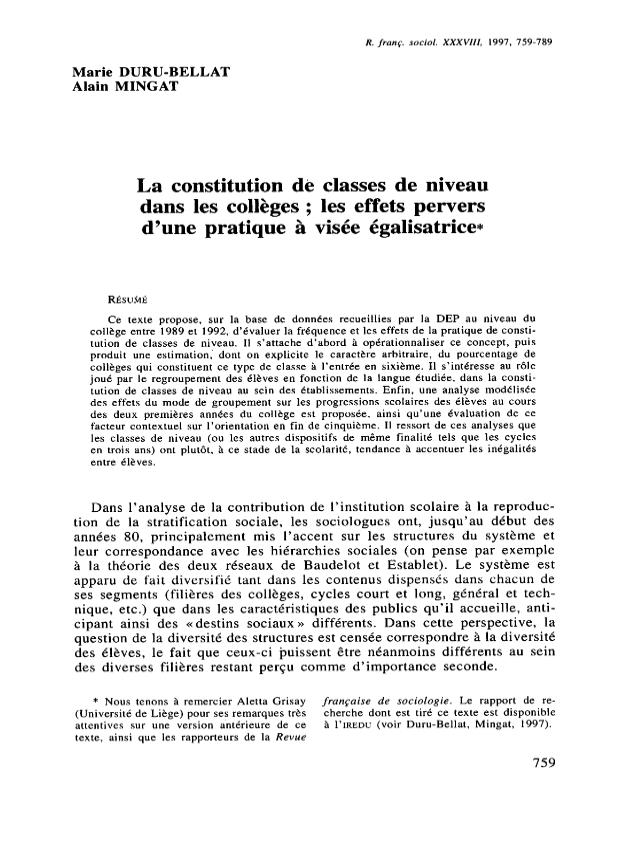Dans le cadre des 50 ans de l’IREDU, Marie Duru-Bellat a accepté de nous parler plus précisément de l’un de ses articles, paru dans la Revue Française de Sociologie en 1997 intitulé « La constitution de classes de niveau dans les collèges ; les effets pervers d’une pratique à visée égalisatrice » (vous pouvez cliquer sur son image à droite de cet écran pour le télécharger). Écrit en collaboration avec Alain Mingat, cet article fait partie des publications qui ont marqué l’histoire du laboratoire.
Marie Duru-Bellat est sociologue ; en 1983 elle est nommée enseignante-chercheuse en sciences de l’éducation à l’Université de Bourgogne. Ses thèmes de recherches sont les inégalités sociales et sexuées à l’école, la stratification sociale et les politiques et dynamiques éducatives.
« Pouvez-vous restituer cette publication dans votre carrière ? »
« Après avoir commencer à travailler dans l’éducation nationale, j’ai préparé une thèse à l’IREDU, que j’ai soutenu en 1978. J’ai ensuite continué à travailler avant d’obtenir un poste de maître de conférences en 1982-1983, date à laquelle j’ai intégré l’IREDU. Cette publication intervient donc 20 ans après ma thèse : j’avais donc déjà un peu d’ancienneté et j’étais intégrée à l’IREDU. Durant ma carrière, j’ai beaucoup travaillé avec Alain Mingat, d’abord sur les effets maîtres, et sur d’autres choses dans cette perspective-là qui était assez nouvelles à l’époque. »
« Comment a émergé cette question de recherche ? »
Marie Duru-Bellat : « Il faut bien voir que dans le contexte de ces années 1980-1990, la sociologie est très déterministe. A la suite du succès (mérité) du travail de Bourdieu et Passeron, on pense que la réussite à l’école est strictement déterminée par l’origine sociale, et que c’est la fonction du système scolaire. Quand par exemple on a commencé à travailler avec Alain Mingat dans les années 1980 sur les effets du contexte scolaire (au-delà des effets des caractéristiques personnelles des élèves), les chefs d’établissement nous ont dit « pourquoi travailler là-dessus, on n’a aucune marge de manœuvre, vous n’allez rien trouver… ». Et tout le monde a essayé de nous décourager.
A la fin des années 1980, on a écrit un premier article qui montrait que l’établissement scolaire fréquenté, à lui seul, pouvait être associé à plus ou moins d’inégalités sociales. De la même manière, Alain Mingat à la fin des années 1980 avait montré qu’il y avait des effets maîtres (sur les progressions des élèves et les inégalités sociales afférentes). Tout ceci paraît à présent banal, mais à l’époque c’était très nouveau.
Notre objectif a vraiment été d’examiner les marges de jeu, d’une certaine manière, de la détermination globale du milieu familial. On a fait d’abord des travaux sur les effets établissements, et la question des classes de niveau est venue après. C’est assez logique, on avait vu qu’il y avait des variations selon les établissements et puis c’était une question qui, au niveau pédagogique était souvent posée parce que le collège unique voulu par la réforme Haby avait commencé à se mettre en place progressivement. Il avait été très critiqué, beaucoup de gens disaient « il y a trop d’hétérogénéité, il faut faire des classes de niveau, comme ça les plus faibles progresseront plus… ». C’était une vraie question pédagogique, donc il y avait à la fois un intérêt théorique, et puis ça répondait à une interrogation chez les enseignants mais aussi chez le ministre. »
« Quel était l’enjeu scientifique de cette recherche ? »
Marie Duru-Bellat : « Les enjeux scientifiques, on les voit souvent après… Nous, on se disait que c’était important de continuer à explorer ces marges de jeu, est-ce que la classe dans laquelle on est peut faire une différence, et puis après de regarder comment ça se met en place. C’est vrai que pour cet article-là, il y avait peut-être un enjeu pédagogique plus important que sur d’autres sujets, et puis il y a eu une opportunité ; le ministère de l’Education Nationale, avec qui on était en relation, nous a dit, « j’ai une base de données », or c’est lourd les données à collecter, donc là, la DEPP nous dit « J’ai une base de données, où on suit des collégiens quelques années, si vous voulez l’exploiter, on vous la donne. » On a dit oui, ce qui nous a permis d’avoir des matériaux pour explorer cette question qui était très dans l’air du temps, le fait de constituer des classes de niveau et leur impact sur les élèves. »
« Vous avez travaillé à deux sur cet article avec M. Mingat, comment s’est passée votre collaboration ? »
Marie Duru-Bellat : « On a beaucoup travaillé ensemble avec Alain Mingat, alors bon, distinguer un peu des points forts des uns ou des autres, ce n’est pas facile ! Disons que j’ai une formation qui est moins solide sur le plan économétrique par exemple, qu’Alain Mingat qui est économiste, mais que, quand il faut situer notre questionnement dans le cadre de la littérature, notamment sociologique, je suis peut-être plus à l’aise, j’aime beaucoup écrire, on n’écrit pas de la même manière d’ailleurs, ça peut créer des tensions, moi j’écris vite et je réécris, Alain Mingat, lui il cisèle ses phrases… C’est presque stéréotypé cette division du travail, moi je suis plus la littéraire sociologue et lui l’économiste, économètre disons. »
« Avez-vous bénéficié d’apports déterminants de certaines lectures théoriques ou méthodologiques ? »
Marie Duru-Bellat : « Non. Non parce qu’en France il n’y a rien de toute façon ; j’avais fait auparavant une synthèse des travaux anglo-saxons, mais les effets des groupes de niveau ne jouaient pas toujours dans le même sens selon les travaux. »
« Quels étaient les aspects les plus novateurs du papier ? Était-ce cette question de l’effet établissement qui était inédite à l’époque ? »
Marie Duru-Bellat : « Oui, on reprenait cette question de l’effet établissement et on explorait comment le fait de constituer des classes de niveaux pouvait en être une composante. Après, il y avait une démarche visant à chiffrer ce phénomène. Les débats autour des classes de niveau sont importants à l’époque, mais personne ne sait précisément ce que c’est. On se dit qu’on va mettre les bons ensemble etc…, mais à partir de quel seuil on va dire que l’on a constitué une classe (de niveau) de « bon » niveau ?
Il y a un travail qu’on a toujours aimé faire avec Alain Mingat, c’est se demander comment on donne une contrepartie empirique à une idée générale, comment on va la construire puis la mesurer. Et donc ça c’est toute une partie du travail qu’on a fait, mais en explicitant bien que, comme toujours, ça dépend comment cette mesure est construite ; on ne peut pas dire « il y a 50% de classes de niveau », on va forcément avoir des fourchettes, parce qu’il y a des questions de seuil. Est-ce qu’une classe s’écarte plus ou moins de la moyenne de l’établissement, est-ce que l’hétérogénéité est plus ou moins réduite ? Ça dépend des limites qu’on a définies… Nous avions aussi la volonté de verser dans le débat pédagogique des éléments méthodologiques propres à la recherche. »
« Les résultats obtenus vous ont-ils surpris ? »
Marie Duru-Bellat : « On pensait bien qu’il y avait des classes de niveau… On m’aurait demandé ex-ante quelle est l’importance de ce phénomène… Je ne sais pas, je n’avais pas vraiment d’estimation chiffrée. Ce à quoi on pouvait s’attendre c’est que les établissements fassent d’autant plus souvent des classes de niveau que leur population est hétérogène. Or, ce n’est pas ce qu’on a observé. On a observé par ailleurs, ça on pouvait le prévoir, que les classes de germanistes permettaient aux élèves de davantage progresser ; on s’est alors un peu amusé à démonter cette histoire d’ « effet allemand » : ce n’est pas parce que l’allemand rend intelligent, mais parce on va les grouper dans des bonnes classes et que ceci est le facteur qui favorise les progressions. Il y a un côté assez ludique dans les modèles, on introduit une variable, on en enlève une autre, on regarde comment ça fonctionne, donc ça ce n’était pas vraiment une surprise mais, on l’a chiffré.
Le plus important sans doute, ce sont les résultats sur la progression des élèves, montrant que selon l’hétérogénéité et le niveau moyen de la classe on va progresser plus ou moins. Grâce à la base de données assez solide dont nous disposions, on peut dire que ceux qui progressent le moins sont vraiment les élèves regroupés dans les classes de niveau faible, homogène et faible. Ce qui est aussi important comme résultat sur les effets des classes de niveau, c’est la comparaison entre ce que perdent les faibles (quand ils sont dans des classes homogènes faibles) et ce que gagnent les forts, quand ils sont dans des classes homogènes fortes. Dans les classes de niveaux, ce que perdent les faibles est deux fois plus important que ce que gagnent les forts. Ce résultat (dont l’incidence politique n’est pas négligeable) était impossible à prévoir. »
« Votre publication a-t-elle fait l’objet de débat ? De critiques ? »
Marie Duru-Bellat : « Non, des critiques non. Mais cet article est intéressant (et original) puisque nos résultats ont été cités par le ministère de l’éducation à l’appui d’une circulaire interdisant de faire des classes de niveau de germanistes. On est toujours contents de voir citer ses travaux, mais concernant les réactions des collègues, dans le milieu sociologique, on avait porté plus d’attention à l’article précédent sur les effets de contexte, les effets établissement car c’était nouveau et bousculait un peu les théories de la reproduction. Mais dans le milieu scientifique je ne pense pas que ça soit l’article qui ait eu le plus d’écho. »
« Y-a-t-il eu des prolongements à l’IREDU ? »
Marie Duru-Bellat : « Non, pas à ma connaissance. Mais il y a deux ans, des économistes ont recherché des effets établissement et des effets de classe. Ils ont trouvé la même chose que nous, mais ils ne nous ont pas cité, tant les jeunes économistes ignorent les travaux soit qui leur paraissent anciens soit émanant de sociologues…. »
« Les résultats sont-ils toujours d’actualité ? Pourquoi ? »
Marie Duru-Bellat : « Ça dépend si l’on fait toujours des classes de niveau dans les établissements, quoique je pense qu’il y a quand même une méfiance grandissante du côté du ministère et des chefs d’établissements envers cette pratique. Elles sont peut-être moins fréquentes, en particulier les groupements par langue, qui doivent être moins répandus. Pour que les résultats ne soient plus valables il faudrait qu’on ne fasse plus de classes de niveau ou que les enseignants aient développé une pédagogie spécifique pour ces classes, donc je pense que les grandes tendances sont toujours valables. »
« Rétrospectivement, auriez-vous changé quelque chose à l’article ? »
Marie Duru-Bellat : « Je ne pense pas, car l’opérationnalisation des classes de niveau ça me paraît une méthodologie toujours valable. Cependant, évaluer les progressions des élèves ça serait plus facile aujourd’hui car on a de bonnes épreuves d’évaluations standardisées. A l’époque c’était quand même assez peu répandu. On prendrait les épreuves disponibles, on ne changerait pas grand-chose au dispositif global, on aurait seulement des instruments peut-être un peu plus perfectionnés.
« Pourquoi cette publication dans cette revue ? »
Marie Duru-Bellat : « Parce qu’à l’époque dans le domaine de la sociologie c’était la plus prestigieuse. De plus, on est une équipe CNRS, on est évalué sur nos articles dans les grandes revues ; on aurait pu, comme on l’a fait pour les effets maîtres, publier dans la revue française de pédagogie, mais c’est vrai qu’il y avait un aspect un petit peu technique, qui était assez apprécié dans la revue française de sociologie. »
Entretien réalisé par Léa Mouflin, stagiaire à l’IREDU en Février 2021